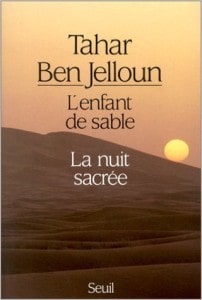Il y a déjà plusieurs mois que j’ai lu ce double-roman de Tahar Ben Jelloun. L’histoire singulière d’une femme élevée comme un homme par son père, sous le nom d’Ahmed dans L’enfant de sable et qui, à la mort de ce dernier, décide de retrouver sa féminité et de redevenir Zahra dans La nuit sacrée. Un double-roman qui m’a intéressée, happée et passionnée à plus d’un titre. Des textes qui rendent hommage à la femme et aborde des thèmes en avance sur leur temps, puisque le premier a été publié en 1985 et le second en 1987.
J’aurais pu choisir de publier ici des extraits sur le corps, sur la féminité, sur ce que c’est d’être femme/homme, sur le genre, la sexualité, des extraits érotiques aussi. Mais j’aurais vraiment eu du mal à choisir. Je ne peux donc que vous recommander de vous plonger dans ces ouvrages qui, tout en empruntant à l’atmosphère des Mille et Une Nuits, sont profondément modernes et se font étendard de la liberté.
Je voudrais cependant partager avec vous cette lettre qui arrive sur la fin de La nuit sacrée et qui est l’une des plus belles lettres d’amour qu’il m’ait été donné de lire à ce jour :
Ami,
Je charge l’humilité des mots de vous dire l’ombre vacillante du souvenir, ce qui me reste de votre poème. Cela fait à présent quelques mois, peut-être un siècle, que vers vous je marche, les bras en avant comme cette statue dans la légende qui avance vers la mer. Je ne suis pas derrière vous, mais j’ai pris le chemin inverse pour être à votre rencontre, pour que nos visages se retrouvent, éclairés par la même lumière. J’avance et sous mes pieds je sens qu’une partie de moi dans la terre s’enracine. L’épaisse couche des ténèbres qu’autour de moi j’organise me sert d’asile. Elle me couvre et me protège, tantôt crinière, tantôt voile hissée contre la lumière. Nous sommes, vous et moi, du même rêve comme d’autres sont du même pays, je ne dirais jamais de la même famille. Comme l’écho d’un chant matinal, votre voix se penche sur moi et m’accompagne dans ma marche. Voix nue sans mots, sans phrases, juste la chaleur d’un murmure. Là où nous sommes, les saisons se succèdent nous effleurer ; elles vont et viennent là-bas derrière les montagnes. Pour notre amitié – vous dites amour, vous -, je ne fais aucune prière. Elle est hors des mots. C’est une plante aux feuilles larges plantée dans ma conscience et dans mon coeur. Elle m’empêche de me décomposer et de faillir à l’attente. Il m’arrive d’être atteinte de tristesse ; une stupide et lourde tristesse m’enveloppe comme une cape d’étoiles mortes. Alors je ne fais rien. Je laisse passer ces moments qui me séparent de vous. Vous vous éloignez et votre regard se détourne. Je le sais et je n’y peux rien. Je me nourris tellement de cette émotion que je sens à la seule pensée de vous. Le temps dans lequel je marche est un désert, et le sable est tantôt froid tantôt brûlant. Je porte d’épaisses chaussettes de laine et dans sandales de nomade. Je prends soin de mes pieds parce que la route est longue. Je sais le temps comme un fleuve profond et inconsistant. Je le suis. Il est le sens qui mène vers le lieu de notre prochaine rencontre.
Ami, j’espère que cette lettre vous parviendra alors que vous êtes en bonne santé. Ici, comme vous le savez, il ne me manque que la vue de votre visage. De mon attente à votre retour, l’étendue d’une mer bleue. Je vous baise les mains.