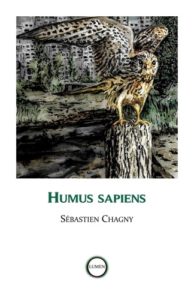Oui, je sais, c’est le dernier jour d’août, autant dire le dernier jour d’été dans le subconscient collectif, on est à la veille de la rentrée des classes et en pleine rentrée littéraire, et je viens vous parler de mes lectures coup de cœur de l’hiver et du printemps derniers, autant dire des lectures datant de Mathusalem ! D’autant plus que les deux ouvrages dont je vais vous parler aujourd’hui ne sont apparus, il me semble, dans aucune liste de rentrée littéraire officielle, ni cette année, ni celle d’avant, ni aucune autre.
Oui, j’ai un certain plaisir malicieux à publier cette note de lecture « à contretemps » car j’ai une sainte horreur des rythmes (infernaux) imposés. Mais c’est aussi pour vous rappeler, s’il le fallait, qu’aucun livre n’est intrinsèquement assorti d’une date limite de lecture ou d’une saisonnalité. Les travers de la consommation de masse et une certaine obsolescence programmée affectent aussi le monde du livre désormais. Mais ce n’est pas parce qu’un ouvrage n’est pas/plus sur les étagères, ou n’y est pas particulièrement mis en valeur, qu’il n’existe pas/plus. Il pourra toujours être commandé dans n’importe quelle librairie ou directement à son éditeur.
Je précise à tout hasard que ceci n’est pas une attaque contre les livres de la rentrée littéraire. Les livres ne sont pas responsables des systèmes dans lesquels nous les englobons et j’espère pouvoir lire un grand nombre de ceux qui paraissent ces jours-ci, dans les mois à venir.
Pour clore ce long préambule (mais cela faisait tellement longtemps que je n’étais pas venue vous parler de mes lectures que je me rattrape un peu !) et pour me montrer totalement honnête, il me faut aussi confesser que j’ai manqué de temps pour partager mes lectures en ce premier semestre 2022. J’ai beaucoup lu, mais d’abord et avant tout pour mon travail de traductrice et aussi pour mon projet Métisse. Et alors ? Les ouvrages lus uniquement pour le plaisir ont été moins nombreux. Mais parmi ceux-là, ces deux livres, extrêmement différents l’un de l’autre, m’ont ravi le cœur, d’abord et avant tout par leur langue.
On m’appelle Nina
Antoinette Tidjani Alou
Présence Africaine, 2017
Coup de cœur absolu ! Il y a tant de choses que je voulais vous dire sur ce livre, mais je n’ai malheureusement pris aucune note au moment de ma lecture il y a plusieurs mois maintenant. Je vais donc commencer par vous raconter ma rencontre avec cet ouvrage.
Ce sont plusieurs sympathisants de l’association Les Ami.e.s du Sahel – qui m’avait invitée à exposer en mars dernier – qui me l’ont mis entre les mains. Notamment Michel Richard, comédien, qui a réalisé un énorme travail d’adaptation de ce récit en une lecture de 45 min, qu’il m’a chaleureusement conviée à dire à deux voix avec lui. Cette lecture a été présentée au local de l’association au début du mois de mai dernier. Ce fut un moment très fort pour moi de porter ce texte à voix haute, après avoir traversé la lecture si riche en émotion et poésie.
On m’appelle Nina peut être qualifié d’autofiction et commence ainsi :
« On m’appelle Nina. Ce n’est pas mon vrai nom. A la naissance, dans mon pays loin là-bas, on m’appelait Vilhelmina. Comme ça avec un V. Pour les Haussa, c’est un nom impossible, il n’y a pas de v dans leur alphabet. Il me semble que moi aussi je suis impossible. Je suis trop. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas à ma place. Je suis trop « je ». Vaste problème. (…)
Qui est à sa place ? Vaste question. Et que vient faire une Vilhelmina dans cette histoire ? Une femme des îles n’est ni une femme de la savane africaine, ni une femme des sables sahéliens. D’où vient alors ce « nous » ambigu, instable, nécessaire, m’associant à ces gens qui ne peuvent pas dire mon nom ? »
La narratrice/autrice est née en Jamaïque et, après un passage par la France, s’est installée au Niger où elle vit depuis plus de vingt-cinq ans. Elle porte désormais les deux nationalités et son expérience peut être comparée à celle de Maryse Condé, avec en plus le franchissement de la frontière linguistique de l’anglais au français, langue adoptée qu’elle maîtrise à la perfection.
On m’appelle Nina raconte la lutte pour faire sa place dans l’exil, le dépaysement, l’adaptation, l’adoption, dans un univers où le « je » et le « nous » covivent presque sans répit. C’est une lutte qui traverse l’ensemble de l’être, esprit et corps. Le choc est aussi bien culturel que physique. C’est une langue sensuelle, sans concession, qui pèse chaque mot, fait de réguliers clins d’œil au Cantique des Cantiques (entre autres) et distille une affection et un amour féroces :
« Feindre, au nom de la paix ? A cette paix-là je préfère mille guerres, toutes ouvertes. Je te mangerais bien la peau et les yeux, parce que tu as trahi et que je suis inassouvie et insoumise : je ne me rendrai jamais. Je veux ta peau et je veux que tu le saches. Je ne me couche plus devant la demi-vie. Je veux tout, et le pain et la mie, et j’exige ça juste de moelleux et pas plus, ferme comme il faut, mais sans excès, cuit à point et point trop. »
On m’appelle Nina raconte aussi la pire des pertes pour une mère, celle d’un enfant, avec une délicatesse et une justesse organiques qui comblent les gouffres de l’âme.
On m’appelle Nina entremêle tous les mondes dont la narratrice/autrice a tout à la fois transgressé et transcendé les frontières, en y posant des yeux qui observent aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.
On en a à peine achevé la lecture qu’on en redemande !
J’ai hâte, désormais, de lire la deuxième oeuvre de Antoinette Tidjani Alou, un recueil de nouvelles en anglais cette fois, intitulé Tina Shot Me Between the Eyes and other stories. Et j’espère qu’il y aura d’autres occasions de présenter la lecture créée avec Michel Richard.
Humus Sapiens
Sébastien Chagny
Editions de l’Abat-Jour, Collection Lumen (Poche), 2020
Humus Sapiens est un recueil de nouvelles, toutes indépendantes les unes des autres, mais qui tissent ensemble le récit de l’effondrement des sociétés des humains et l’avènement du règne animal et végétal.
Si j’ai été sensible à la dénonciation et au jugement de l’inhumanité crasse de l’Homo sapiens qui n’a de sage que le nom dont il s’est lui-même couronné, je me suis surtout délectée du style extrêmement savoureux de l’auteur. Il est copieusement riche, peut parfois emmener au bord de l’indigestion, mais juste au bord. Il m’a beaucoup fait penser à celui d’un auteur que j’ai déjà traduit à deux reprises pour… les Editions de l’Abat-Jour, à savoir M. P. Shiel (Xélucha paru en 2018 et La maison des sons à paraître début 2023). La langue de Sébastien Chagny est cependant plus contemporaine et moins prétentieuse que celle de Shiel. Mais je ne suis pas certaine qu’il serait plus simple à traduire !
Il y a là de l’ironie, voire du cynisme ; de l’irrévérence, voire des touches de vulgarité ; de la poésie, énormément de poésie, avec des trouvailles à faire pâlir de jalousie toutes les meilleures plumes de la Création, des chapelets de jeux de sons et de sens. Je n’ai pu m’empêcher de le lire à haute voix à maintes reprises. Un pur bonheur (même si cela demande beaucoup de souffle !). On se laisse recouvrir avec volupté du terreau si vivant de cet Humus sapiens. Chapeau bien bas, Monsieur Chagny !
(Je déconseille cependant vivement la lecture de cet ouvrage à toute personne atteinte de solastagie ou d’éco-anxiété !)
Bonne(s) lecture(s) à vous !
(Je viendrai probablement, dans les prochains mois, vous parler de mes lectures estivales pendant l’automne de la rentrée littéraire ; et des livres de la rentrée littéraire pendant l’hiver. Oui, c’est tout moi, et ce n’est pas près de changer !)